
Le Cardinal Charles-Martial
Lavigerie 1825-1892
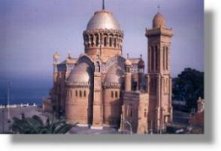
6. Afrique du Nord
 Lavigerie
arrive en Afrique en 1867 avec le titre d'archevêque d'Alger,
et son premier souci porte sur la situation dans la colonie. Depuis
la conquête française, le territoire se trouve sous
administration militaire, et celle-ci interdit pratiquement tout
contact entre les prêtres et les Algériens par crainte
d'un prosélytisme agressif susceptible de provoquer de violentes
réactions. Le système est renforcé au plus
haut niveau par l'option de l'empereur Napoléon III en faveur
d'un "Royaume arabe" distinct des zones de colonisation.
Le nouvel archevêque s'insurge contre cette barrière
et n'hésite pas à en appeler à l'opinion de
son pays contre la politique officielle. L'affaire fait du bruit,
car elle s'entremêle avec les conséquences de catastrophes
naturelles dont l'Algérie souffre depuis deux ans: épidémies
et sécheresse provoquant la famine chez les populations arabes.
Lavigerie recueille de nombreux orphelins abandonnés et mourant
de faim, mais il dénonce aussi les carences de l'administration
qui n'a pas su prendre les mesures nécessaires en temps voulu.
Un conflit, qui laissera des traces, l'oppose au gouverneur général
Mac-Mahon. Lavigerie
arrive en Afrique en 1867 avec le titre d'archevêque d'Alger,
et son premier souci porte sur la situation dans la colonie. Depuis
la conquête française, le territoire se trouve sous
administration militaire, et celle-ci interdit pratiquement tout
contact entre les prêtres et les Algériens par crainte
d'un prosélytisme agressif susceptible de provoquer de violentes
réactions. Le système est renforcé au plus
haut niveau par l'option de l'empereur Napoléon III en faveur
d'un "Royaume arabe" distinct des zones de colonisation.
Le nouvel archevêque s'insurge contre cette barrière
et n'hésite pas à en appeler à l'opinion de
son pays contre la politique officielle. L'affaire fait du bruit,
car elle s'entremêle avec les conséquences de catastrophes
naturelles dont l'Algérie souffre depuis deux ans: épidémies
et sécheresse provoquant la famine chez les populations arabes.
Lavigerie recueille de nombreux orphelins abandonnés et mourant
de faim, mais il dénonce aussi les carences de l'administration
qui n'a pas su prendre les mesures nécessaires en temps voulu.
Un conflit, qui laissera des traces, l'oppose au gouverneur général
Mac-Mahon.
Plusieurs
centaines parmi les enfants recueillis, trop épuisés,
meurent rapidement. D'autres sont restitués aux familles
qui viennent les chercher Huit cents restent à la charge
de l'archevêque. Avec les sommes reçues à la
suite de son appel à l'opinion, il peut acheter des terres
sur lesquelles ces orphelins devenus adultes s'établiront
après leur mariage et dont ils deviendront propriétaires
à terme. Ayant reçu une éducation chrétienne
suivie du baptême, Lavigerie espère que ces familles,
vivant selon leur foi, constitueront un exemple attirant pour leurs
voisins musulmans. Les plus aptes aux études les poursuivent
à différents échelons. Cinq d'entre eux deviendront
docteurs en médecine. Ne pourront-ils eux aussi porter témoignage
de leur foi par leur compétence et leur dévouement
?

Lavigerie au milieu d'orphelins recueillis par lui
.(click pour agrandir)
Lavigerie
désire en effet reconduire les populations de l'Afrique du
Nord à la religion de leurs ancêtres qui surent donner
à l'Eglise de grands évêques et des martyrs.
Il ne veut pas pour autant s'engager dans un prosélytisme
intempestif ou utiliser des moyens de pression quelconques : ces
méthodes sont inacceptables à ses yeux. Lors de son
conflit avec le gouverneur général, le ministre de
la Guerre l'accusa de vouloir porter atteinte à la liberté
de conscience des Algériens. La réponse est formelle
:
" Non, Monsieur le Ministre, mille fois non,
je ne peux à aucun degré porter atteinte à
la liberté de la conscience; à aucun degré
je ne veux ni de la force, ni de la contrainte, ni de la séduction
pour amener les âmes à une foi dont la première
condition est d'être libre ",
 Les
directives données aux missionnaires suivent ce principe.
En Kabylie, les jésuites étaient présents depuis
1863. Dix ans plus tard, les Pères Blancs s'établissent
en trois villages, puis fondent d'autres postes les années
suivantes, et les Sœurs Blanches ouvrent à leur tour
plusieurs maisons. Tous reçoivent des instructions extrêmement
strictes. D'abord apprendre la langue et s'y perfectionner pour
établir un véritable contact avec les gens qui les
entourent. Si la conversation aborde le plan de la religion, ne
parler que des points sur Dieu et la morale admis par les interlocuteurs:
toute prédication chrétienne est interdite même
en privé. Ne pas provoquer de conversions individuelles nécessairement
fragiles dans un milieu où quelques néophytes isolés
ne pourraient tenir longtemps. C'est le milieu lui-même qu'il
faut faire évoluer en créant un climat de compréhension.
Dans une première étape de durée indéterminée,
les missionnaires doivent donc se Les
directives données aux missionnaires suivent ce principe.
En Kabylie, les jésuites étaient présents depuis
1863. Dix ans plus tard, les Pères Blancs s'établissent
en trois villages, puis fondent d'autres postes les années
suivantes, et les Sœurs Blanches ouvrent à leur tour
plusieurs maisons. Tous reçoivent des instructions extrêmement
strictes. D'abord apprendre la langue et s'y perfectionner pour
établir un véritable contact avec les gens qui les
entourent. Si la conversation aborde le plan de la religion, ne
parler que des points sur Dieu et la morale admis par les interlocuteurs:
toute prédication chrétienne est interdite même
en privé. Ne pas provoquer de conversions individuelles nécessairement
fragiles dans un milieu où quelques néophytes isolés
ne pourraient tenir longtemps. C'est le milieu lui-même qu'il
faut faire évoluer en créant un climat de compréhension.
Dans une première étape de durée indéterminée,
les missionnaires doivent donc se  borner
à soigner les malades et à faire l'école, laissant
le temps faire son oeuvre sans vouloir agir avec une précipitation
qui compromettrait irrémédiablement l'avenir. Cette
longue patience est une rude ascèse pour certains missionnaires
pressés de voir le résultat de leurs efforts, mais
Lavigerie maintient fermement la ligne tracée par lui. borner
à soigner les malades et à faire l'école, laissant
le temps faire son oeuvre sans vouloir agir avec une précipitation
qui compromettrait irrémédiablement l'avenir. Cette
longue patience est une rude ascèse pour certains missionnaires
pressés de voir le résultat de leurs efforts, mais
Lavigerie maintient fermement la ligne tracée par lui.
Malgré
ou à cause de cette approche fort respectueuse des mentalités,
la question du baptême se posa après une quinzaine
d'années. Outre l'école fréquentée par
des externes, les missionnaires entretenaient dans leurs postes
quelques internes, orphelins reçus en accord avec les conseils
de villages ou enfants confiés par les parents. La familiarité
avec les Pères éveilla chez un certain nombre d'entre
eux le désir du baptême. Lavigerie avait expressément
réservé son autorisation personnelle pour conférer
le sacrement, et sa première réaction fut de refuser
une démarche encore trop précipitée à
ses yeux. Il se laissa finalement convaincre et, en 1888, trois
jeunes Kabyles recevaient le baptême à Rome dans le
cadre d'un pèlerinage organisé à l'occasion
du jubilé d'or sacerdotal de Léon XIII. Au retour
dans leur pays, ils se marièrent avec des jeunes filles élevées
chez les Sœurs.
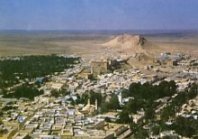 Outre
la Kabylie, les Pères Blancs s'orientèrent dans une
autre direction: le Sahara et le Soudan, régions sur lesquelles
Lavigerie avait obtenu la délégation apostolique du
Saint-Siège. Pour atteindre la seconde, il fallait traverser
le désert avec tous ses périls dûs aux circonstances
géographiques et humaines. Trois missionnaires, partant du
sud algérien, s'y engagent en 1876: ils sont massacrés
par leurs guides. Trois de leurs confrères, en 1881, tentent
de suivre une autre voie au départ de Ghadamès: ils
subissent le même sort. La pénétration vers
l'intérieur du continent africain paraît bien impossible
de ce côté. Les tentatives ne seront pas renouvelées
durant la vie du fondateur. Outre
la Kabylie, les Pères Blancs s'orientèrent dans une
autre direction: le Sahara et le Soudan, régions sur lesquelles
Lavigerie avait obtenu la délégation apostolique du
Saint-Siège. Pour atteindre la seconde, il fallait traverser
le désert avec tous ses périls dûs aux circonstances
géographiques et humaines. Trois missionnaires, partant du
sud algérien, s'y engagent en 1876: ils sont massacrés
par leurs guides. Trois de leurs confrères, en 1881, tentent
de suivre une autre voie au départ de Ghadamès: ils
subissent le même sort. La pénétration vers
l'intérieur du continent africain paraît bien impossible
de ce côté. Les tentatives ne seront pas renouvelées
durant la vie du fondateur.
 L'Afrique
du Nord, c'est aussi la Tunisie, et Lavigerie pense plus spécialement
à Carthage, le siège épiscopal prestigieux
d'une Eglise si florissante aux premiers siècles de l'ère
chrétienne. Le ressusciter devient pour lui un impératif.
Devenu administrateur du vicariat apostolique de Tunisie en 1881,
il organise activement cette nouvelle juridiction en sorte d'obtenir
du pape, trois ans plus tard, sa transformation en archevêché
autour de l'antique siège officiellement rétabli.
Il en reçoit le titre tout en conservant celui d'Alger dont
l'administration cependant est confiée à un coadjuteur.
C'est à Carthage qu'il réside dès lors habituellement,
et ses qualités d'organisateur se déploient. Les tâches
sont larges et variées: attirer ou former un clergé
en rapport avec une population européenne en croissance;
construire églises, écoles et séminaire; suggérer
aux autorités et participer lui-même à des mesures
d'ordre économique et social, telles que la sauvegarde de
l'hygiène, la création d'hôpitaux, la sécurité
publique, la mise en valeur de terres par irrigation. L'Afrique
du Nord, c'est aussi la Tunisie, et Lavigerie pense plus spécialement
à Carthage, le siège épiscopal prestigieux
d'une Eglise si florissante aux premiers siècles de l'ère
chrétienne. Le ressusciter devient pour lui un impératif.
Devenu administrateur du vicariat apostolique de Tunisie en 1881,
il organise activement cette nouvelle juridiction en sorte d'obtenir
du pape, trois ans plus tard, sa transformation en archevêché
autour de l'antique siège officiellement rétabli.
Il en reçoit le titre tout en conservant celui d'Alger dont
l'administration cependant est confiée à un coadjuteur.
C'est à Carthage qu'il réside dès lors habituellement,
et ses qualités d'organisateur se déploient. Les tâches
sont larges et variées: attirer ou former un clergé
en rapport avec une population européenne en croissance;
construire églises, écoles et séminaire; suggérer
aux autorités et participer lui-même à des mesures
d'ordre économique et social, telles que la sauvegarde de
l'hygiène, la création d'hôpitaux, la sécurité
publique, la mise en valeur de terres par irrigation.
 Renouer
les liens avec l'Eglise d'Afrique du Nord des premiers siècles,
c'est aussi en découvrir les restes, et ils sont nombreux,
surtout en Tunisie. Un Père est spécialement désigné
pour cette tâche, Louis Delattre, qui se passionne vite pour
ces recherches. Son nom ne tarde pas à être connu parmi
les spécialistes, et il entretiendra une importante correspondance
scientifique. Un de ses confrères, Anatole Toulotte, entreprend
de son côté un vaste travail d'érudition sur
le même sujet. Lavigerie lui-même y participe quand
il peut réserver certains moments dans une existence fort
chargée. Un tel intérêt n'est pas suscité
par la simple connaissance historique, mais par un patrimoine à
faire revivre comme une source d'approfondissement. C'est dans cette
vue qu'il reprend la chaîne, longtemps interrompue, des conciles
d'Afrique du Nord avec celui d'Alger en 1873 et de Carthage en 1890.
En outre, sur le plan liturgique, il développe le culte des
saints qui ont illustré l'Eglise dans cette région
durant l'antiquité. Renouer
les liens avec l'Eglise d'Afrique du Nord des premiers siècles,
c'est aussi en découvrir les restes, et ils sont nombreux,
surtout en Tunisie. Un Père est spécialement désigné
pour cette tâche, Louis Delattre, qui se passionne vite pour
ces recherches. Son nom ne tarde pas à être connu parmi
les spécialistes, et il entretiendra une importante correspondance
scientifique. Un de ses confrères, Anatole Toulotte, entreprend
de son côté un vaste travail d'érudition sur
le même sujet. Lavigerie lui-même y participe quand
il peut réserver certains moments dans une existence fort
chargée. Un tel intérêt n'est pas suscité
par la simple connaissance historique, mais par un patrimoine à
faire revivre comme une source d'approfondissement. C'est dans cette
vue qu'il reprend la chaîne, longtemps interrompue, des conciles
d'Afrique du Nord avec celui d'Alger en 1873 et de Carthage en 1890.
En outre, sur le plan liturgique, il développe le culte des
saints qui ont illustré l'Eglise dans cette région
durant l'antiquité.

Sarcophage chrétien à El Kef
|